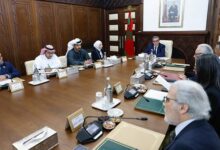Développement NMDS : un plan Marshall à 85 milliards de dirhams
Lancé en 2015, le Nouveau modèle de développement des provinces du Sud constitue une initiative stratégique visant à transformer durablement les provinces sahariennes. Doté d’investissements exceptionnels et reposant sur les principes de participation, d’inclusion et de durabilité, ce programme a permis de renforcer les infrastructures, de dynamiser l’économie locale et de créer de nouvelles opportunités d’emploi. Bilan.
Lancé par le Roi Mohammed VI lors de son discours de Laâyoune le 6 novembre 2015, le Nouveau modèle de développement des provinces du Sud (NMDPS) marque un tournant majeur dans la politique de développement du Maroc. À la fois projet économique, social et territorial, il se veut le dernier maillon d’un processus historique d’intégration des provinces sahariennes au sein du Royaume.
Ce modèle, doté d’une enveloppe financière exceptionnelle de 77 milliards de dirhams, portée depuis à 85 milliards, s’inscrit dans une logique de durabilité, d’inclusivité et de participation, tout en consolidant la souveraineté nationale sur ces territoires stratégiques. Un récent Policy brief de Policy center for the New South (PCNS), produit par Henri-Louis Vedie, économiste français, en dit long sur le chemin parcouru. Sur la période 2015-2025, le NMDPS a connu un rythme de réalisation soutenu, faisant émerger de nouveaux pôles de croissance dans des régions longtemps marginalisées.
Aujourd’hui, tous les projets qu’il comprend sont achevés ou en cours d’achèvement. Le tout est réparti entre quatre grands volets prioritaires : les infrastructures, les énergies renouvelables, la technopole de Foum El Oued, et le développement social et environnemental.
Les infrastructures ont absorbé près de 16 milliards de dirhams, avec trois chantiers emblématiques. Le premier est la voie express Tiznit-Dakhla sur près de 1.000 kilomètres, véritable colonne vertébrale logistique du Sud marocain. Le deuxième est le port atlantique de Dakhla, conçu comme un hub maritime et industriel d’envergure continentale. Le troisième est la connexion au réseau électrique national.
Ces projets structurants ont permis d’améliorer la mobilité, de désenclaver des territoires isolés et de renforcer les échanges commerciaux vers l’Afrique subsaharienne. La technopole de Foum El Oued, dotée de deux milliards de dirhams, constitue le pivot de la stratégie d’innovation et de formation. Inspirée du modèle de Benguérir, elle vise à attirer les jeunes talents, les startups et les institutions de recherche autour d’un pôle universitaire à faible empreinte carbone.
Le secteur des énergies renouvelables a bénéficié d’un investissement colossal. Les provinces du Sud disposent d’un potentiel éolien et solaire exceptionnel, exploité à travers les parcs de Tarfaya, Akhfennir, Boujdour et Aftissat. Ces projets contribuent à faire du Sahara marocain un acteur clé dans la transition énergétique nationale et la sécurité d’approvisionnement du pays.
Enfin, les volets social et environnemental mobilisent plusieurs milliards de dirhams, notamment à travers le Centre hospitalier universitaire de Laâyoune, les unités de dessalement d’eau de mer et les programmes d’assainissement. Ces investissements ont significativement amélioré la qualité de vie des habitants, tout en renforçant la résilience face aux contraintes climatiques et sanitaires.
Entre 2016 et 2019, le NMDPS a connu une phase de déploiement accéléré. Selon la Commission nationale des investissements, le taux moyen d’avancement des projets atteignait 70%, avec un taux d’engagement financier supérieur à 50%. Dans la seule région de Laâyoune-Sakia El Hamra, près de 280 projets ont été lancés avant 2019. La période 2020-2022, marquée par la crise de la COVID-19, a constitué un test de résilience.
Alors que la plupart des économies régionales accusaient un ralentissement, les provinces du Sud ont maintenu un rythme d’investissement soutenu, avec 267 nouveaux projets engagés en 2021 pour un montant global de 33 milliards de dirhams. La poursuite du port de Dakhla, le projet d’irrigation de 5.000 hectares par dessalement d’eau de mer et l’extension des parcs éoliens illustrent cette continuité.
Depuis, la machine a repris et de plus belle. Au bout de 10 ans de mise en œuvre, le programme est en voie d’atteindre tous ses objectifs. Exemple :
la voie Tiznit-Dakhla est quasiment achevée. Le port Dakhla Atlantique avance à grands pas. Son achèvement est prévue pour fin 2028.
Les impacts
Les résultats macroéconomiques confirment l’efficacité du modèle. En 2021, les taux de croissance régionale atteignaient 10,9% pour Laâyoune-Sakia El Hamra et 10,5% pour Dakhla-Oued Eddahab, contre une moyenne nationale nettement inférieure. Le PIB par habitant s’établissait à plus de 89.533 dirhams en 2023, soit plus du double de la moyenne nationale, témoignant d’une amélioration sensible du niveau de vie.
L’émergence de pôles de compétitivité (halieutique à Dakhla, industriel à Boucraâ, agricole à Boujdour et touristique à Laâyoune) illustre la diversification économique en cours. Ces pôles contribuent à la création de milliers d’emplois directs et indirects, à la montée en valeur ajoutée locale et à l’intégration de ces provinces dans les chaînes de valeur nationales et africaines. Malgré ces avancées remarquables, plusieurs défis demeurent.
Le chômage, bien qu’en baisse, reste supérieur à la moyenne nationale, traduisant un déséquilibre entre la formation des jeunes et les besoins des nouveaux secteurs. La dépendance encore marquée à l’investissement public limite le développement du secteur privé local, notamment des PME. De plus, la durabilité environnementale, particulièrement en matière de gestion de l’eau et de préservation des écosystèmes côtiers, exige une vigilance continue.
L’enjeu des prochaines années sera de consolider les acquis du NMDPS en renforçant la gouvernance locale, en accélérant la décentralisation budgétaire et en favorisant l’investissement privé national et international. Le pari est grand. La mise en réseau des trois régions du Sud avec les corridors logistiques vers l’Afrique de l’Ouest, via le port de Dakhla et la voie express Tiznit-Dakhla, positionnera le Sahara marocain comme plateforme stratégique de la coopération Sud-Sud.
En attendant, le Nouveau modèle de développement des provinces du Sud constitue l’un des projets économiques les plus ambitieux de l’histoire contemporaine du Maroc. En moins d’une décennie, il a transformé la physionomie économique, sociale et territoriale de ces régions, tout en confirmant leur ancrage définitif au sein du Royaume.
La genèse d’une stratégie
L’histoire contemporaine des provinces du Sud s’inscrit dans un long processus de décolonisation et de consolidation de la souveraineté marocaine. Depuis la Marche Verte de 1975 et les accords de Madrid, le Maroc a progressivement reconstruit ces territoires, longtemps sous-administrés par la puissance coloniale espagnole.
L’initiative marocaine d’autonomie, présentée à l’ONU en 2007, a renforcé cette dynamique en proposant une solution politique réaliste et crédible, fondée sur la souveraineté marocaine et la gestion locale démocratique. Sur le plan géographique, les provinces du Sud couvrent plus de 60% du territoire national mais abritent moins de deux millions d’habitants.
Ce déséquilibre démographique, conjugué à une urbanisation rapide (plus de 70%), a imposé des arbitrages économiques précis pour adapter les infrastructures et les services publics aux besoins des populations, concentrées dans les pôles urbains de Laâyoune, Dakhla et Guelmim.
L’ancrage institutionnel du NMDPS s’appuie sur la régionalisation avancée, instaurée par la Constitution de 2011 et mise en œuvre dès 2015. Trois grandes régions structurent désormais le Sahara marocain : Dakhla-Oued Eddahab, Laâyoune-Sakia El Hamra et Guelmim-Oued Noun. Chacune dispose d’institutions élues, de budgets propres et de compétences décentralisées, assurant une gouvernance locale mieux articulée avec la politique nationale de développement.
Un programme, trois piliers
Le NMDPS s’inscrit dans la continuité des efforts de mise à niveau, entamés depuis les années 1970, mais en renouvelle profondément les fondements économiques et sociaux. Le premier modèle, centralisé, avait permis de doter les provinces du Sud des infrastructures de base – routes, logements, électrification, accès à l’eau potable, mais sans parvenir à générer une économie locale durable. Le NMDPS, lui, vise explicitement la création de richesse endogène et la participation active des acteurs régionaux.
Sa philosophie repose sur trois principes structurants. Le premier est la participation. La planification du développement régional est désormais fondée sur la concertation avec les élus locaux, conférant une légitimité démocratique à la mise en œuvre des projets. Le second est l’inclusion. Il s’agit de faire des populations locales les premières bénéficiaires du développement, en veillant à ce que les richesses produites dans les provinces soient réinvesties sur place. Enfin, la durabilité constitue le troisième pilier, garantissant la préservation des ressources naturelles (halieutiques, agricoles, énergétiques) et la transition vers une économie bas-carbone.
Ilyas Bellarbi / Les Inspirations ÉCO