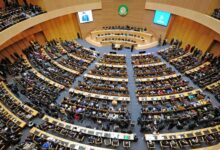Une vague judiciaire sans précédent ébranle les réseaux de corruption
Ciblant aussi bien la majorité que l’opposition, une série de poursuites judiciaires vise désormais trente députés marocains pour corruption ou détournement de fonds publics. Cette vague inédite s’inscrit dans une stratégie d’assainissement plus large, qui touche également le secteur immobilier et les rouages mêmes de la justice.
Jamais le Parlement marocain n’avait connu une telle hémorragie judiciaire. Trente députés, soit près de 8 % des élus, sont aujourd’hui poursuivis ou condamnés pour corruption, détournement de fonds publics ou abus de pouvoir, selon des données révélées par Jeune Afrique. Un chiffre inédit qui traverse l’échiquier politique, avec seize élus issus de la majorité et quatorze de l’opposition.
Le Rassemblement national des indépendants (RNI), principal parti de la coalition gouvernementale, détient le record : huit de ses parlementaires font face à la justice. Parmi eux, Mohamed Boudrika, incarcéré pour malversations financières, et Rachid El Fayek, condamné à cinq ans de prison pour traite d’êtres humains et viol sur mineur. Le Parti authenticité et modernité (PAM) n’est pas épargné : quatre de ses élus, dont Saïd Naciri, sont impliqués dans l’affaire du « Pablo Escobar du Sahara ». Du côté de l’Istiqlal, la chute est incarnée par Mohamed Karimine, maire de Bouznika, condamné à sept ans de prison pour dilapidation de deniers publics.
Lire aussi : CDH : Le Maroc appelle à placer les droits de l’homme au cœur des efforts anti-corruption
Cette vague de procédures s’inscrit dans un mouvement plus large d’assainissement qui dépasse la sphère parlementaire. La justice a récemment frappé au cœur des institutions judiciaires elles-mêmes : à Tétouan, plusieurs magistrats et avocats ont été condamnés pour vente de jugements, illustrant la volonté d’atteindre les réseaux de corruption au-delà des seuls élus.
L’opération, qualifiée par certains de « mains propres » à la marocaine, vise notamment des secteurs longtemps jugés opaques, comme l’immobilier, où s’entrecroisent intérêts politiques et économiques. Elle traduit une stratégie assumée : restaurer l’autorité de l’État et rétablir la confiance d’une opinion publique lassée par la répétition des scandales.
Reste une question : cette offensive judiciaire amorce-t-elle une réforme durable des pratiques politiques et administratives, ou n’est-elle qu’un épisode spectaculaire dans un système dont les ressorts profonds demeurent inchangés ?