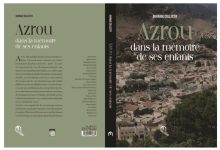Mondial 2030 : L’héritage en jeu
L’organisation de manifestations sportives mondiales telles que les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde est traditionnellement perçue comme un puissant catalyseur de développement économique et un moyen privilégié d’améliorer les infrastructures nationales. Toutefois, ces événements peuvent également révéler les faiblesses structurelles préexistantes d’un pays, entraînant parfois des conséquences économiques durables, bien au-delà des festivités initiales. L’héritage de la Coupe du Monde 2030 cristallise les attentions au Maroc.
L’histoire contemporaine des compétitions sportives internationales nous a souvent offert des exemples éloquents : la Grèce après les Jeux Olympiques d’Athènes en 2004, le Brésil après la Coupe du Monde 2014 ou encore l’Afrique du Sud suite au Mondial 2010, autant de situations complexes où l’investissement massif ne s’est pas nécessairement traduit par les retombées espérées, aggravant même certaines crises économiques existantes. À l’approche de la Coupe du Monde 2030, coorganisée avec l’Espagne et le Portugal, le Maroc est confronté au défi majeur de bâtir un héritage durable, dépassant largement le cadre sportif initial.
Conscient des exigences strictes imposées par la FIFA, le Maroc s’est engagé dans un plan de modernisation sans précédent de ses infrastructures sportives. Ce programme, évalué entre 15 et 20 milliards de dirhams, prévoit notamment la rénovation complète de sites emblématiques tels que le Complexe Mohammed V à Casablanca et le Grand Stade de Marrakech. Par ailleurs, des projets novateurs voient le jour, à l’instar du futur Grand Stade de Benslimane qui pourra accueillir jusqu’à 115 000 spectateurs.
Pour accueillir la Coupe du Monde 2030, le trio formé par le Maroc, l’Espagne et le Portugal a prévu la mise à disposition de vingt stades respectant les normes internationales, dont six seront situés au Maroc. Le Royaume ambitionne ainsi de créer des infrastructures polyvalentes destinées à accueillir aussi bien des compétitions sportives internationales que des événements culturels et communautaires. Bien utilisées, ces installations pourraient devenir de véritables moteurs de développement local et des vecteurs efficaces de promotion des pratiques sportives auprès de la jeunesse.
Lire aussi : Coupe du Monde 2026 : L’interdiction de voyage menace la participation de plus de 40 pays
Toutefois, la simple construction d’infrastructures modernes ne suffit pas à garantir un héritage positif. Une politique publique ambitieuse et inclusive doit être définie pour assurer un accès démocratisé aux installations sportives, particulièrement pour les jeunes talents et les sportifs amateurs. La question centrale reste l’utilisation optimale de ces espaces : faut-il réserver ces stades exclusivement aux compétitions internationales prestigieuses ou les rendre accessibles à une pratique sportive régulière et inclusive, y compris dans les disciplines moins médiatisées que le football ?
Selon les experts, les grands événements internationaux doivent être perçus comme une opportunité d’innovation et d’ouverture vers une gestion à long terme, transformant les stades en véritables lieux de vie, ouverts également à des événements culturels et éducatifs. L’intégration de ces infrastructures dans un projet plus global, combinant éducation, sport et culture, apparaît ainsi comme une approche pragmatique et nécessaire.
Un catalyseur économique et social prometteur
Les retombées économiques anticipées pour ces compétitions sportives sont considérables. L’Observatoire du Travail Gouvernemental estime que la Coupe d’Afrique des Nations 2025 pourrait rapporter près de 1,5 milliard de dirhams en recettes touristiques, tandis que le Mondial 2030 pourrait générer entre 8 et 10 milliards de dirhams. Au-delà du tourisme, de nombreux autres secteurs, tels que le bâtiment, les transports et les technologies de l’information, devraient également profiter de cette dynamique.
La gestion post-événementielle de ces installations reste néanmoins cruciale. Un expert en politiques sportives rappelle ainsi que de nombreux stades construits pour des événements majeurs restent sous-utilisés ou finissent même totalement abandonnés : «Le véritable défi pour le Maroc sera d’assurer une continuité effective». C’est dans cette perspective que le pays envisage notamment des partenariats public-privé afin d’optimiser la gestion et d’assurer une rentabilité durable de ces infrastructures.
Construire un modèle marocain exemplaire
En anticipant les défis à venir, le Maroc pourrait devenir un modèle de gestion sportive sur le continent africain, démontrant qu’il est possible de concilier organisation d’événements sportifs majeurs et héritage économique et social pérenne. Une étude récente du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) avait déjà relevé certaines insuffisances de la «Stratégie nationale du sport à l’horizon 2020», principalement dues à des difficultés de mise en œuvre et un manque de moyens.
Pour éviter ces écueils, le CESE préconise désormais une approche mieux intégrée, articulant efficacement sport scolaire, universitaire et professionnel, tout en harmonisant le cadre juridique et en instaurant un système de suivi rigoureux des politiques et infrastructures mises en place.
En somme, l’ambition du Maroc dépasse de loin le simple cadre organisationnel de ces compétitions : elle s’inscrit dans un véritable projet sociétal, où le sport devient un levier de développement humain et économique durable, capable de transformer profondément le paysage national et d’inspirer durablement les générations futures.
Un coût onéreux
La Coupe du monde 2030, organisée conjointement par le Maroc, l’Espagne et le Portugal, représenterait un investissement total de 15 à 20 milliards de dollars pour le trio. La part du Maroc s’élèverait à environ 5 milliards de dollars, soit près de 52 milliards de dirhams. Selon l’étude de Sogécapital Gestion, cette enveloppe se répartirait ainsi : 17 milliards de dirhams pour la construction et rénovation des stades, 8 milliards pour les centres d’entraînement, 17 milliards pour les transports et infrastructures, et 10 milliards pour les coûts d’organisation généraux. Le financement des stades et centres d’entraînement, évalué à 25 milliards de dirhams, serait entièrement pris en charge par l’État entre 2024 et 2030. Par ailleurs, 17 milliards seraient mobilisés par des entreprises publiques via des crédits bancaires ou le marché de la dette privée, et 10 milliards par des prêts concessionnels et aides internationales. Outre des retombées importantes pour des secteurs comme le BTP et le tourisme, cet investissement devrait renforcer la visibilité internationale du Maroc et générer de nombreux emplois, tout en préservant la stabilité macroéconomique malgré une augmentation prévue des importations d’environ 25 milliards de dirhams (1,5 % du PIB).